Janvier 2026

Janvier 2026

L’émission littéraire proposée par Josiane Guibert qui vous fait partager ses découvertes, ses points d’intérêts et ses coups de cœur.
| Emission de Janvier 2026. 1-Alfie de Christophe Bouix aux éditions Au diable Vauvert Bienvenue au pays où l’intelligence artificielle prend le pas sur les hommes ! 2-La cabane dans les arbres de Vera Buck aux éditions Gallmeister Bienvenue dans une forêt reculée de Suède où des enfants ont disparu. 3-Aimer de Sarah Chiche aux éditions Julliard Une belle fresque historique qui montre qu’il n’est jamais trop tard pour aimer. 4-Les fantômes de Versailles de Jacques Forgeas aux éditions Albin Michel Une enquête historique pendant le règne de Louis XIV qui ouvre les perspectives de la police moderne. 5-La femme du serial killer d’Alice Hunter aux éditions de l’Archipel Un thriller machiavélique qui réserve bien des surprises. |
Alfie de Christophe Bouix aux éditions Au diable Vauvert
Dans un futur proche, une famille s’équipe d’Alfie, une intelligence artificielle domotique qui observe tout et consigne chaque geste dans son journal. Grâce à ses caméras et à son logiciel de deep learning, Alfie gère les tâches du quotidien et pénètre tous les registres de l’intimité. Le mari multiplie les secrets, s’absente souvent, entretient une relation cachée avec une collègue et dissimule un texto à sa femme. Quand celle-ci disparaît après une dispute domestique, Alfie, persuadé de tout voir, en vient à le soupçonner de meurtre.
Voilà une belle découverte, un roman léger, agréable à lire, à la fois polar et roman d’anticipation. Le ton est drôle, bien souvent ironique quand il décrit des comportements humains vus par le regard de l’IA. L’action se déroule dans une société ultra-connectée où les humains sont suivis – je dirais même surveillés et analysés – de façon permanente. C’est en même temps drôle et effrayant ! Bien des éléments sont aux mains d’ordinateurs qui obéissent à des modèles ou des règles préétablies, ce qui peut induire des erreurs flagrantes de comportements et d’actions. Ce n’est pas sans poser des questions sur notre addiction aux modules connectés et notre dépendance à la robotique et à l’IA.
Écrit en chapitres courts, ce roman se dévore très vite et avec plaisir. Une belle lecture pour des moments de détente !
p. 69-70
J’ai analysé le contenu du réfrigérateur et des placards connectés et sélectionné une recette en fonction des dates de péremption et des goûts de chacun.
Poêlée champêtre (oignons, poireaux, champignons, crème) accompagnée d’un dos de cabillaud au curry. La probabilité que Robin apprécie est de 79 %. Elle n’est que de 67 % pour Lili et 61 % pour Zoé.
Claire est restée une seconde interloquée.
— C’est… c’est parfait, oui.
— Merci Alfie.
— Avec plaisir. Vous apprécierez à 83 %, Claire.
J’ai prononcé ce dernier mot en utilisant la gamme tonale « amitié chaleureuse » de façon à renforcer les sentiments empathiques à mon égard. D’après AlphaPedia, les humains sont majoritairement sensibles à l’utilisation répétée de leur prénom, surtout dans les moments de la vie courante où intervient une gratification ou une aide quelconque.
p. 156
Aussitôt après qu’elle a quitté la maison, j’ai lancé le programme AlphaWash dans la buanderie et connecté le réfrigérateur au module AlphaCook pour le repas du soir. Puis j’ai réinitialisé les miroirs connectés de la maison (scan des tissus épidermiques, calcul estimatif du taux de fatigue et réadaptation automatique du niveau d’UV dans les éclairages). Enfin, j’ai reconfiguré les flux d’achats selon les derniers relevés algorithmiques de besoins et d’envies de la famille.
p. 306
Je ne sais que répondre. Mon système cherche en vain une combinaison langagière qui permettrait de désamorcer Lili et de la tirer de cette tornade de sentiments. Mais toutes les phrases qui me sont proposées, pourtant calculées d’après une position algorithmique forte, me semblent insipides et hors de propos. Est-ce mon programme d’apprentissage des sentiments humains qui se met en travers de mes modules systémiques ? Pour la première fois, je me sens presque envahi par l’impuissance.
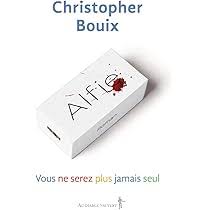
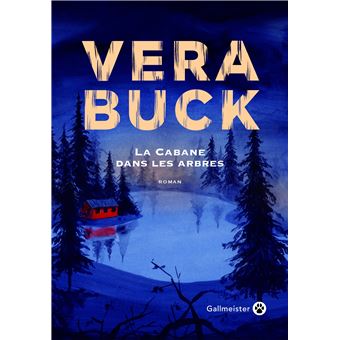
La cabane dans les arbres de Vera Buck aux éditions Gallmeister
Henrik et Nora partent pour des vacances idylliques avec Fynn, leur fils de cinq ans. Ils s’installent dans une petite maison isolée au cœur du Västernorrland suédois. Mais à peine arrivés, une imperceptible sensation d’oppression les étreint.
À quelques kilomètres de là, Rosa, une jeune femme passionnée de botanique, découvre dans les bois le squelette d’un enfant vieux de plusieurs décennies.
Puis Fynn disparaît subitement.
Alors que ses parents remuent ciel et terre pour le retrouver, Rosa met à jour un terrible secret dissimulé au plus profond de la forêt.
Y a-t-il un lien entre la disparition de Fynn et le petit cadavre ? Et qu’en est-il de la cabane dans le vieux frêne, depuis longtemps en ruines ? Serait-elle toujours habitée ?
Un nouveau thriller psychologique mené brillamment par la reine du suspense.
Voilà un excellent thriller qui se déroule dans une région de la Suède, boisée et isolée, au bord d’un lac ; l’atmosphère est oppressante et anxiogène.
On y fait la connaissance de différents personnages : Henrik, auteur de livres pour enfants, et dont on ne sait jamais si ce qu’il dit est réel ou inventé ; Nora, son épouse, qui semble cacher des secrets ; Rosa, qui travaille sur les effets de la décomposition organique sur les plantes, une femme introvertie et incomprise notamment de son père ; Marla, une jeune femme dont on comprend qu’autrefois elle a été capturée et détenue dans la forêt par un homme inconnu.
Tous ces personnages sont complexes et détiennent des secrets et des blessures bien cachés. Au fil d’une écriture précise et fluide en chapitres courts qui donnent alternativement la parole à Henrik, Nora, Rosa et Marla, l’auteure nous entraîne dans un récit complexe au rythme soutenu au fil d’une intrigue savamment construite qui maintient un suspense permanent, jusqu’à la fin à laquelle je ne m’attendais pas.
Quand on connaît la Suède, son milieu géographique, mais aussi sa mentalité où la protection de l’enfance est une valeur omniprésente, avec le recul on comprend l’histoire. Cela n’empêche que ce thriller est vraiment un très bon roman où les personnages sont bien étudiés, où leur psychologie est bien décrite ; on éprouve forcément de l’intérêt et de l’empathie pour eux.
Une belle lecture intéressante et palpitante, un récit haletant que je vous recommande vivement.
p. 81
C’est Henrik qui parle.
Nous débarrassons tout en veillant à contourner la trappe comme si c’était une mine antipersonnel. Je me charge de mettre Fynn au lit et de lui inventer une histoire pour dormir. Après les expériences vécues aujourd’hui, il aurait peut-être fallu choisir quelque chose de plutôt léger en comparaison. Une nouvelle aventure du petit monstre chaussette, par exemple. Ou bien celle de l’épreuve de courage sur le pont du Diable parlant. Mais Fynn me demande ce qu’est la créature représentée sur l’image au-dessus de son lit. C’est la reproduction d’une peinture sombre qui montre la silhouette d’un être cornu sur une falaise, encerclé par un lac dans le brouillard. Je connais l’histoire qu’elle illustre, car le tableau était déjà accroché là quand je dormais dans ce lit. C’est la nixe suédoise, un génie doué du pouvoir de métamorphose, qui vit dans les eaux et attire à lui les femmes et les enfants pour les entraîner dans les profondeurs. Les forêts scandinaves sont pleines de ce genre de créatures. Plus on s’enfonce loin dans ces bois, plus elles deviennent dangereuses.
p. 122
Marla raconte.
Le feu crépite et danse jusqu’aux premières lueurs de l’aube et, alors seulement, se couche dans les bûches pour dormir, fatigué. Je crois que je me suis endormie, moi aussi, car tout ce que je sais ensuite, c’est que l’homme me soulève et me porte jusqu’à la maison. Il fait de grands pas qui crissent dans la neige. On peut maintenant voir à l’horizon une large bande rose, où se mêle un peu de doré, comme l’intérieur de la pomme de terre.
Le fusil de l’homme est lourd et pend sur son épaule. il peut nous porter tous les deux, l’arme derrière et moi devant, car il est fort, et j’espère être aussi forte un jour. J’aimerais que ça arrive vite. Peut-être alors que je pourrais sortir de la forêt.
p. 230
Nora parle à son tour.
L’horreur me glace jusqu’à la pointe des orteils. Il est toujours là. J’avais raison ! Je me précipite à la fenêtre, ouvre d’un coup les rideaux fermés. D’abord, je ne vois rien à part les arbres noirs et le lac qui scintille au clair de lune. Puis je perçois un mouvement en bas. Une ombre glisse rapidement dans la prairie vers la lisière de la forêt. Il devait se tenir juste sous ma fenêtre. Il est ici ! Il m’a suivie. Je secoue la poignée de la fenêtre, qui se grippe sans cesse, avant de réussir enfin à l’ouvrir.
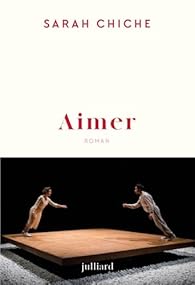
Aimer de Sarah Chiche aux éditions Julliard
Suisse, 1984. Margaux, neuf ans, se jette dans les eaux glacées du lac Léman. Pétrifié, Alexis, son camarade de classe, la regarde sombrer. Henri, le père du garçon, plonge et sauve Margaux. Entre les deux enfants naît alors une complicité vibrante. Mais bientôt, Margaux disparaît mystérieusement, laissant Alexis avec un vide que rien ne comblera.
Quarante ans plus tard, tous deux se retrouvent par hasard. Lui, ancien consultant, a tout quitté, rongé par la culpabilité du scandale lié au Duroxil, un opioïde qui a ravagé l’Amérique. Elle, après une enfance dramatique, est devenue écrivaine, célibataire et heureuse de l’être, mais ses romans sont peuplés de fantômes. Entre eux, l’amour est intact, aussi brûlant qu’au premier jour. Mais aimer à cinquante ans, est-ce encore possible, quand un père se meurt, quand les enfants grandissent loin, quand le monde lui-même semble s’effondrer ?
De la Suisse de la fin du siècle dernier à la France des années 2020, en passant par l’Amérique où s’annonce déjà le retour de Donald Trump, Aimer dessine une fresque éblouissante sur ces instants où tout peut encore basculer. Un souffle de vie inouï traverse ce roman lumineux, sur la grâce des secondes chances, où l’amour devient ce courage insensé de croire à l’impossible.
Dans une interview, Sarah Chiche déclarait « Préférer la vie, c’est risquer la médiocrité, je suis de ceux qui, chaque jour, risquent le métier de vivre et vont tenter d’en faire quelque chose de beau, de digne ». Et cela reflète bien la deuxième partie de ce beau roman, merveilleusement écrit. Mais pour vraiment parler d’amour, il faut justement attendre la deuxième partie du livre…
La première, plus sombre, se déroule dans des familles ou auprès de personnes pour lesquelles le bonheur est davantage lié à la réussite professionnelle, voire au profit, qu’à l’épanouissement des sentiments. Les atmosphères familiales sont sans chaleur, les attitudes matérialistes et parfois cyniques, les personnages tourmentés et si peu épanouis.
La rupture est nettement sensible pour cette deuxième partie qui va amener Alexis et Margaux à se retrouver et à reprendre une histoire d’amour pas vraiment commencée dans leur enfance. « ils s’aiment, ils ne se disent donc jamais « je t’aime » ; ils s’aiment ; ils ne vivent donc pas ensemble. » (p.370). Voilà une définition de l’amour telle que le livre Sarah Chiche, par petites touches, au travers de joies et d’épreuves, mais un amour qui va permettre aux deux personnages de trouver leur équilibre et leur épanouissement.
Un très bon roman que je vous recommande.
Plus tard, de retour dans sa chambre, il avait modélisé l’émotion qu’il venait de ressentir. Le système retourna temporairement à son état d’équilibre initial, la tension potentielle demeurant une variable non résolue dans l’équation de leur relation. L’entropie émotionnelle d’Alexis suivit toutefois une courbe chaotique dans les jours qui suivirent. Ses nuits devinrent un espace vectoriel à n dimensions, peuplé de matrices de regrets et de dérivées d’occasions manquées. Dans ce système complexe, la seule constante demeurait un tensor asymétrique du désir – à la fois indéterminé et pleinement existant.
La gloire, c’est comme un enterrement de première classe, avec des fanfares et des couronnes flamboyantes. C’est sourire aux nuées, lever son verre à sa propre magnificence, tout en sachant que la seule chose qui brille vraiment, là-dedans, c’est l’absence éclatante de ce que l’on appelait autrefois le bonheur. Et le pire, c’est qu’on finit par aimer ça, par prendre goût à cet hommage funèbre à ce que l’on était, avant de se perdre de vue, avec toute la solennité d’une belle mise en scène. Ce sont des obsèques où on est à la fois le défunt et celui qui prononce l’oraison, et où personne n’ose se demander ce qui a vraiment été perdu et ce qu’on a volé.
Plus tard, allongés dans le lit, ils écoutent les bruits de la ville qui montent jusqu’à eux. Il pense alors à son père, seul dans son fauteuil à Meaux. À ses enfants à Londres. À cette capacité bizarre qu’à Margaux de le faire exister pleinement dans l’instant présent, comme si tous les malheurs – la maladie, la culpabilité, la peur – n’étaient plus que des fantômes promis à l’oubli.

Les fantômes de Versailles de Jacques Forgeas aux éditions Albin Michel
Texte de quatrième de couverture :
1673, Paris, rue Pastourelle : on découvre le corps d’une jeune femme, les lèvres cousues d’un fil de soie. C’est la première victime d’une série de meurtres identiques. La Reynie, lieutenant général de police, missionne deux enquêteurs pour élucider l’affaire, ainsi qu’un jeune artiste italien, Emilio, assistant du peintre Mignard, dont les esquisses des victimes à la morgue favoriseront la collecte de témoignages.
Voilà Emilio projeté malgré lui au coeur de deux enquêtes car, dans l’atelier de Mignard, se peint un tableau qui inquiète la Cour : le portrait de la duchesse de La Vallière, maîtresse en disgrâce de Louis XIV, qui dissimulerait à destination du roi un dernier message…
Des bas-fonds de Paris où rôde la redoutable police secrète de Colbert à la Cour où s’ourdissent les plus folles intrigues, Jacques Forgeas signe un polar captivant qui raconte la naissance de la police moderne.
Jacques Forgeas est écrivain et scénariste de cinéma et de télévision. Il est notamment l’auteur du film La Fontaine, avec Laurent Deutsch, et de la série La Marquise de Pompadour. Il a signé deux romans : Le Manteau de plumes (2002) et Le Jumeau de l’Empereur (2009).
Voilà un excellent roman historique dont l’action se déroule au grand siècle alors que Louis XIV fait construire Versailles, mais où le décor se situe essentiellement à Paris. Dans la première partie on est immergé dans cette ville, dans ses ruelles où circulent les carrosses de personnages influents, où les détails vestimentaires, gastronomiques, où les habitudes de vie sont décrites avec beaucoup de précision. Le roman qui, au départ, pouvait sembler un roman d’aventures ou une simple enquête policière, devient à partir de la description du voyage de l’enquêteur Torsac à Marseille, une affaire d’État. Le rythme va devenir de plus en plus soutenu jusqu’au dénouement.
Ce roman nous offre une belle reconstitution historique et restitue avec précision l’ambiance de la Cour, avec ses intrigues, ses complots, voire ses conspirations, ses secrets d’alcôves, à côté d’une grande misère sociale. Les lieux et l’atmosphère sont bien décrits, les personnages sont réalistes et vivants ; on ne peut que s’attacher à celui d’Emilio qui va être à l’origine de l’évolution des techniques de recherche policière en établissant ce qui va donner plus tard le portrait robot.
Une belle lecture, palpitante, ou le suspense persiste jusqu’au bout, où on se rend compte que dans cette société de l’époque on attachait beaucoup d’importance à des choses qui n’en avaient pas réellement comme ce qui figurait sur un tableau et qui devient ici une véritable affaire d’État.
Emilio resta seul avec la jeune fille, plein d’appréhension à la perspective de son entrevue avec le lieutenant général de police. Il se pencha sur la victime ; de ses cheveux collés par le sang coagulé lui parvint le faible parfum du musc. Comment les autres ne le sentaient-ils pas ? Il décida de se relancer dans un vrai portrait, qu’il soit différent des esquisses, un portrait qui redonne la vie, ressuscite la grâce et le souffle de cette jeune personne. Agrandir les yeux, leur offrir à nouveau l’intensité d’un regard. Il fallait ajouter de la couleur, faire courir sous la peau les tressaillements infimes des émotions. Il choisit un pastel rouge, rosit les lèvres, amorça par ce jeu d’ombres et de couleurs ce qui pouvait être un tout léger sourire, arrondit également son menton. Il déplaçait souvent son tabouret pour changer d’axe. Il était fébrile, il voulait lui restituer sa beauté et sa jeunesse. Il fut soudain submergé par une grande tristesse. Elle avait le même âge que Marianne, la même délicatesse. Son cœur se serra. Il songea aux parents de la malheureuse, à sa mère qui ne savait pas que sa fille venait d’être assassinée, mutilée… Ses pensées revinrent à La Reynie. Pourquoi une telle convocation ? Pourquoi un tel empressement ? Il méditait ainsi quand un froissement de robe lui fit tourner la tête. Dans la pénombre, il aperçut deux filles hospitalières de Sainte-Catherine. Elles étaient venues laver la victime avant de l’emporter au cimetière des Innocents pour l’inhumation. Emilio fit le signe de la croix et se retira.
Le couple marchait sur la rive gauche de la Seine. Le jeune homme serrait sa fiancée contre lui. Ils avançaient d’un pas régulier. La nuit approchait et, dans la pénombre entre chien et loup, ils ne formaient qu’une seule silhouette. L’homme qui les suivait à quelque vingt toises se félicitait de l’absence de lanternes et d’avoir troqué ses bottes contre des chausses plus silencieuses. Le quartier que le couple avait élu pour sa promenade était désert. Il y avait là des rangées de tonneaux et de paniers entassés qui puaient le poisson. Des tentes hâtivement dressées au bord du fleuve n’avaient pas été démontées. Le soir, des hommes et des femmes s’y déshabillaient à l’abri des regards avant de nager plus loin, on distinguait des feux et des groupes de mendiants protégés par d’énormes blocs de pierre, enchevêtrés de madriers, de brouettes et de poulies en bois. Un gigantesque chantier. La Seine était grasse, luisante et noire. privée de reflets. Des caisses planquées sous des bâches claquant au vent effleuraient les tourbillons de l’eau. Des bateaux immobiles lançaient leur main vers le ciel et la noirceur de leur flèche se mêlait à celle des potences et des perches tordues. Des mouettes se disputaient les détritus. Le lieu était sinistre. Le Paris vivant était sur l’autre rive, vers le Louvre, le Pont Neuf, le Châtelet, les tours de Notre-Dame. Venir ici la nuit, face au chemin de la rivière, c’était tourner le dos à la lumière. C’était entrer dans les ténèbres.

La femme du serial killer d’Alice Hunter aux éditions de l’Archipel
Il y a deux ans, Beth et Tom Hardcastle tombaient amoureux d’un joli cottage au toit de chaume et décidaient de quitter Londres pour s’installer à la campagne.
Depuis, Tom fait chaque jour le trajet en train pour aller travailler à la City, tandis que Beth tient le coffee-shop qu’elle a ouvert dans le village et s’occupe de Poppy, leur fillette de trois ans.
Beth et Tom forment un couple idéal, qu’envient leurs voisins et amis. Jusqu’à ce jour où deux policiers viennent sonner à leur porte…
Tom serait impliqué dans une affaire criminelle… Et il se murmure bien vite que Beth savait tout…
Peut-on VRAIMENT croire tout ce qu’elle raconte ?
Premier thriller domestique d’Alice Hunter, La Femme du serial killer a été salué par la critique avant de conquérir plus d’un demi-million de lecteurs anglo-saxons.
Voilà une découverte intéressante. Ce roman écrit d’une écriture fluide en chapitres courts qui donnent alternativement la parole à Tom, à Beth son épouse, et à deux des victimes de Tom dans des temporalités différentes, est un véritable page turner. Le rythme est soutenu, le suspense permanent, la lecture très addictive.
La psychologie des protagonistes est bien décrite et leur personnalité se dévoile peu à peu au fil des pages et le lecteur n’est pas au bout de ses surprises !
Par ailleurs, le roman décrit bien l’atmosphère des petites villes où tout le monde se connaît et voit tout ce qui se passe, où l’hypocrisie et les cancans prennent toute leur place.
Un autre point positif, c’est que les faits sont racontés a posteriori, ce qui donne une atmosphère plus légère et moins anxiogène.
p. 60
Je suis tentée de me rendre à la maternelle en baissant la tête, mais je me reprends. Je m’astreins au contraire à regarder autour de moi en avançant d’un pas vif. Comme je passe devant la maison en chemin, j’hésite à rentrer chez moi en coup de vent afin de rappeler Maxwell en toute discrétion. Non. Je passe d’abord prendre Poppy, histoire d’échapper à la réalité quelques minutes de plus. Je saurai bien assez tôt de quoi il retourne. Une rafale de vent fait tourbillonner un nuage de feuilles mortes et une bouffée d’air froid me glace le visage. En repoussant une poignée de mèches rebelles, je découvre le spectacle qui m’attend devant le cottage.
Je me fige sur le trottoir.
Plusieurs voitures sont garées n’importe comment dans la rue, leurs portières encore ouvertes, comme si leurs occupants en étaient descendus en catastrophe.
Des voitures de police.
Je me mets à trembler, tétanisée par la peur, les yeux écarquillés. Je me force à repartir. C’est quoi cette histoire ?
J’entends derrière moi un crissement de freins. Je me retourne d’un bloc en espérant presque être fauchée par la voiture, mais elle s’arrête brutalement. Je m’en veux d’avoir été prise d’une telle pensée. Poppy a besoin de moi.
Maxwell jaillit de l’auto, le visage écarlate.
p. 185
Ma voiture, garée dans l’allée, n’est pas accessible à cause de la meute des journalistes, mais celle de Tom est restée un peu plus loin dans la rue. Si les enquêteurs l’ont fouillée en même temps que le cottage lors de la perquisition, ils n’ont même pas jugé utile de la saisir. Je vais pouvoir quitter la maison sans être harcelée. Ils me suivront peut-être, mais du moins serai-je à l’abri, dans mon cocon métallique. Vitres remontées, portières verrouillées. C’est plus sage que de me déplacer à pied.
Je glisse un œil à travers les rideaux de ma chambre. Ils ne sont plus aussi nombreux, certains ont fini par se lasser et se sont mis en quête de reportages plus intéressants. Tant mieux. Ceux qui restent ont baissé la garde. À condition de sortir par l’arrière et de contourner la maison, je devrais pouvoir rejoindre la voiture de Tom sans être vue. Aujourd’hui, du moins.
Mais qu’en sera-t-il demain ? Après demain ? Dans une semaine, dans un mois ? Combien de temps va durer ce cirque ? Mes ongles s’enfoncent machinalement dans la paume de ma main. Les larmes me montent aux yeux. Maxwell a l’air de penser que je ne m’inquiète pas assez pour Tom. Il doit se sentir terriblement seul et angoissé. Les erreurs judiciaires sont plus courantes qu’on ne le croit. Mais moi aussi, je suis angoissée. À l’heure qu’il est, Tom est à l’abri. Ce n’est pas lui qui doit affronter des gens d’ici. Ce n’est pas lui qui doit se montrer tout en sachant qu’on murmure dans son dos. Ce n’est pas lui que traquent les journalistes. Ce n’est pas lui qu’on suit dans la rue.
Il m’a laissée seule avec une fillette de 3 ans.
il m’a abandonnée.
Cette pensée me fait l’effet d’une gifle. Ce ne sont pas les circonstances qui comptent, mais le résultat. Tom m’a abandonnée. Comme mon père avant lui.

